Les contradictions de la politique américaine en Haïti
- Renouvo Demokratik
- 19 oct. 2025
- 6 min de lecture
Par: Alain Zéphyr, Sociologue
Depuis plus de trente ans, Washington oscille entre des proclamations en faveur de la démocratie haïtienne et des pratiques qui en minent les fondements. D'un côté, les États-Unis prônent les élections libres, la stabilité institutionnelle et la lutte contre la corruption. De l’autre, ils appuient des gouvernements de transition dépourvus de légitimité populaire, entretiennent des complicités avec les groupes armés qui déstabilisent le pays. Ils orchestrent également des interventions étrangères qui marginalisent les dynamiques citoyennes et étouffent toute souveraineté démocratique.
Aujourd’hui, cette dissonance atteint un seuil critique. Elle s’enracine durablement dans les domaines stratégiques de la sécurité, de la migration, de l’économie et de la démocratie, révélant une dynamique de domination qui reconduit et normalise l’instabilité.
La sécurité
Cinq années de terreur armée ont désintégré les institutions haïtiennes et plongé le pays dans une crise humanitaire abyssale. L’État haïtien, dépouillé de ses moyens de défense par décret international, est livré nu aux griffes de l’impunité.
Officiellement soumis à un embargo onusien interdisant toute vente, transfert ou fourniture directe ou indirecte d’armes, de munitions, de véhicules militaires, d’équipements paramilitaires et d’assistance technique, il est désarmé par la loi tandis que les gangs, eux, s’arment par les ports.

Des cargaisons entières d’armes expédiées depuis les États-Unis continuent d’alimenter les groupes armés, contournant les contrôles officiels et prospérant dans l’impunité. L’embargo ne protège pas Haïti : il neutralise l’État, tandis que les armes circulent librement vers ceux qui le dévastent.
L’appareil sécuritaire, désormais exsangue, s’est révélé si défaillant que des sociétés militaires privées américaines ont été appelées à la rescousse, siphonnant les dernières ressources nationales.
Dans ce vide orchestré, les États-Unis et leurs alliés internationaux imposent à Haïti des missions sécuritaires rejetées par la population, dépourvues de personnel qualifié, de financement viable et de mandat clair. Ces interventions ne relèvent pas d’une réponse, mais d’un dispositif de façade, une mise en scène sécuritaire destinée à reconduire l’ingérence, maquiller l’échec diplomatique et écraser les volontés populaires sous les oripeaux d’une coopération imposée.
La politique migratoire
Malgré sa reconnaissance officielle de l’insécurité extrême en Haïti, l’administration américaine poursuit ses déportations mensuelles de migrants haïtiens vers ce même chaos.
La fin décrétée du TPS, devenue effective le 2 septembre 2025, enfonce le clou. Alors que le Département de la Sécurité intérieure prétend que le pays est désormais « suffisamment sûr », près de 500 000 ressortissants haïtiens sont renvoyés vers une insécurité qu’on feint d’avoir surmontée.
Cette mécanique d’abandon culmine dans la révocation brutale du programme Biden de Humanitarian Parole, qui avait permis à plus de 210 000 Haïtiens d’entrer légalement aux États-Unis pour deux ans sous condition de parrainage. Présentée comme une réponse humanitaire, cette initiative est aujourd’hui démantelée au nom d’une prétendue incompatibilité avec les intérêts américains. Les bénéficiaires, sommés de quitter le territoire sous trente jours, perdent leur statut, leur droit au travail et toute protection légale.
La double révocation, TPS et Parole, illustre une politique étrangère en rupture avec les réalités du terrain, où les impératifs sécuritaires écrasent les principes humanitaires et instrumentalisent le droit international au service d’une logique migratoire fondée sur le déni, la dissuasion et l’abandon.
L’économie
L’économie haïtienne, déjà fragilisée, s’est enfoncée dans une spirale de contraction sous l’effet direct de la violence armée. Depuis 2018, la montée en puissance des gangs, désormais maîtres des axes commerciaux, des ports, des zones industrielles et des quartiers populaires, a paralysé la production, entravé les échanges et provoqué la fermeture de centaines d’entreprises.
Selon les estimations du RCIA (2024), cette insécurité structurelle a entraîné une chute de près de 40 % de l’activité économique et une perte de plus de 9 milliards de dollars.
En lieu et place d’un appui économique, les États-Unis ont aggravé la situation en démantelant les programmes HOPE et HELP, qui garantissaient aux produits textiles haïtiens un accès préférentiel au marché américain. La fin de ces régimes préférentiels, effective au 1er octobre 2025, a porté un coup fatal au secteur textile, qui représentait près de 90 % des exportations haïtiennes. Ces mesures avaient généré des milliers d’emplois dans les zones franches, notamment à Caracol et à CODEVI, et constituaient l’un des derniers piliers encore debout de l’économie nationale (Vyal, 2025). À ces pertes s’ajoute l’interdiction des mangues Francisque, survenue dès 2022, qui avait déjà amputé l’économie haïtienne d’un débouché agricole vital (Zephyr, 2023).
Pour parachever cette offensive silencieuse, l’administration américaine a imposé des tarifs douaniers de l’ordre de 20 à 30 % sur les produits haïtiens, rendant leurs exportations largement non compétitives face aux marchés asiatiques. Ce retour aux barrières tarifaires classiques condamne Haïti à une marginalisation économique accrue, aggravant le chômage, la pauvreté et l’instabilité sociale.
Ainsi, l’insécurité armée a provoqué l’effondrement économique, et les décisions américaines ont consolidé ce déclin, secteur par secteur. Ce démantèlement progressif ne procède pas d’un retrait passif, mais d’un dessein structuré. Il retire à Haïti ses derniers leviers de subsistance, substitue l’abandon à la coopération et convertit la vulnérabilité en instrument de domination.
La démocratie
Les États-Unis aiment à se présenter comme les garants de la démocratie et du progrès en Haïti. À chaque crise, chaque transition, leurs déclarations réaffirment leur engagement envers les principes démocratiques. Pourtant, sur le terrain, leurs actions racontent une toute autre histoire.
Sous le masque de l’aide, Washington reconduit une logique d’ingérence qui érode les institutions haïtiennes. Appui à des régimes rejetés, silence complice face aux groupes armés, interventions militarisées qualifiées de “missions de paix” : autant de gestes qui ont méthodiquement sapé les fondations de la démocratie haïtienne.
À force de prôner la démocratie tout en soutenant des pratiques qui la contredisent, Washington a transformé le chemin vers la liberté en un parcours semé d’embûches, douloureux et sinueux, Et dans ce paradoxe, c’est la foi du peuple haïtien en la bonne volonté américaine qui s’effrite, jour après jour, promesse après promesse.
Aujourd’hui, alors que les Haïtiens traversent une crise de sécurité publique sans précédent, paralysant l’ensemble des institutions du pays, Washington intensifie la pression pour organiser des élections que beaucoup qualifient de simulacres. Ces scrutins visent à légitimer l’impunité et à reconduire un ordre rejeté par la majorité du peuple haïtien.
Ainsi, la « démocratie à l’américaine » en Haïti s’apparente à une mise en scène méticuleusement orchestrée : un dirigeant contesté, discrédité par la corruption et dépourvu de légitimité populaire, exhibant l’écharpe présidentielle derrière des barbelés, sous la garde de soldats étrangers. Ce tableau, loin d’incarner la souveraineté du peuple, évoque une démocratie confisquée.

Ce n’est pas la voix des urnes qui résonne, mais le bruit des bottes. Ce n’est pas la volonté populaire qui triomphe, mais la persistance d’un ordre imposé, maintenu à bout de bras par des puissances extérieures. Une démocratie sans peuple, sans confiance, sans avenir.
Pour les Haïtiens, la démocratie ne se mesure pas à la tenue d’un scrutin placé sous tutelle, mais à des réalités concrètes : la sécurité, l’éradication de la corruption, le respect de la souveraineté nationale et la capacité collective de bâtir un avenir digne. Or, dans cette quête, les États-Unis ne jouent pas un rôle de partenaire ; ils apparaissent de plus en plus comme un facteur de blocage, perpétuant des rapports asymétriques qui entravent les aspirations populaires haïtiennes.
Crise prolongée, réponse différée : l’urgence d’un projet inclusif et souverain
Les ingérences américaines en Haïti, conjuguées à la soumission des dirigeants haïtiens aux injonctions étrangères, forment le socle de la crise démocratique actuelle. Ces élites, autoproclamées représentantes du peuple, délibèrent et décident en son nom, non pour défendre l’intérêt collectif, mais pour préserver leurs privilèges et alliances. Ce détournement de souveraineté les conduit à ignorer les revendications fondamentales de la majorité : une sécurité digne, une participation citoyenne réelle, et la possibilité de devenir les auteurs de leur propre destinée.
Dès lors, une vérité s’impose avec clarté et urgence : seule la volonté populaire haïtienne peut sauver Haïti
Aujourd’hui, les forces progressistes et populaires haïtiennes sont appelées à franchir un seuil décisif. Elles doivent opérer un saut qualitatif en construisant un projet national qui inclut les victimes de la violence des gangs, les petits paysans, les ouvriers, les jeunes, les intellectuels et tous les laissés-pour-compte de la société haïtienne.
Ce projet ne saurait se limiter à la résolution conjoncturelle de la crise : il doit porter l’ambition de refonder une société nouvelle, inclusive et digne, où chacun puisse participer pleinement à la vie collective et devenir l’auteur de sa propre histoire.
Pendant trop longtemps, les forces de transformation sociale sont restées en marge, laissant le champ libre à des gouvernances successives qui ont précipité le pays dans une crise toujours plus profonde. Elles n’ont jusqu’ici pas su répondre à la demande majoritaire de changement par une offre politique convaincante, articulée autour d’un projet victorieux de transformation structurelle et de réhabilitation démocratique.
L’émergence d’un mouvement populaire, porté par une nouvelle gauche capable de répondre aux urgences haïtiennes par des réformes structurelles, n’est plus une option : c’est une nécessité nationale. Un mouvement de rupture, affranchi des compromis stériles, apte à mobiliser les forces populaires et à refonder les institutions sur des bases de justice, de transparence et de souveraineté démocratique. Telle est l’exigence des masses haïtiennes et la voie la plus sûre vers un renouveau démocratique.

References
Ministère de l’Économie et des Finances, République d’Haïti. (2024). Rapport d’évaluation rapide de l’impact de la crise sécuritaire en Haïti (RCIA). Port-au-Prince : Gouvernement d’Haïti.
Vyal, K. (2025, octobre 1). Fin du programme HOPE/HELP : un coup dur pour l’industrie textile d’Haïti. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/fin-du-programme-hope-help-haiti-textile-2025
Zephyr, A. (2023, July 31). La rareté des mangues francisques aux États-Unis, un symbole de l’aggravation de la crise haïtienne. Boukan News. https://boukannews.com/la-rarete-des-mangues-francisques-aux-etats-unis-un-symbole-de-laggravation-de-la-crise-haitienne






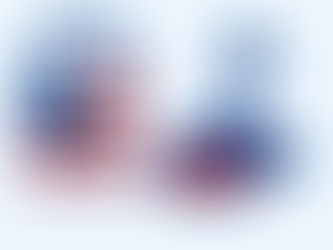





Commentaires