Haïti : vous ne produirez plus, vous dépendrez
- Renouvo Demokratik
- 5 oct. 2025
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 6 oct. 2025
Notre Éditorial,
Par: Alain Zephyr, Sociologue

Dans son édition du 1er octobre 2025, le Wall Street Journal publie un article intitulé « Fin du programme HOPE/HELP : un coup dur pour l’industrie textile d’Haïti ». On y apprend que l’administration américaine a récemment suspendu un programme stratégique qui soutenait l’industrie textile haïtienne, notamment les usines d’assemblage de vêtements destinés à l’exportation. Ce secteur représentait l’un des derniers piliers économiques du pays, assurant l’emploi de plusieurs dizaines de milliers de personnes, majoritairement des femmes.
Pendant près de vingt ans, les programmes HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement) et HELP (Haiti Economic Lift Program) ont permis aux produits haïtiens d’accéder au marché américain sans droits de douane, une exception commerciale vitale. Leur retrait, annoncé par Washington fin septembre 2025, ne marque pas simplement la fin d’un dispositif commercial. Il prive Haïti, étranglée par la crise, d’un levier de production essentiel et d’un outil de résistance économique.
Le textile : un levier de souveraineté retiré par ceux qui prétendent nous aider
La décision américaine ne relève pas d’un simple ajustement technique. C’est un abandon stratégique. En mettant fin à l’un des derniers secteurs industriels d’Haïti, les États-Unis aggravent une précarité déjà extrême.
L’impact a été immédiat et brutal. Des usines ferment, des milliers de travailleurs, majoritairement des femmes, perdent leur emploi. Dans un contexte d’insécurité généralisée, de famine rampante et d’effondrement institutionnel, ce désengagement industriel agit comme un coup de grâce. Là où il y avait encore un semblant de production, il ne reste que le vide.
Washington invoque l’insécurité, les blocages politiques, et l’effondrement de l’État. Mais ces justifications masquent mal une vérité plus crue : l’économie haïtienne n’est plus jugée digne d’investissement, seulement de contrôle. On ne veut plus y produire, on veut y intervenir. On ne veut plus y commercer, on veut y patrouiller
De la Francisque au textile :Washington démantèle, secteur par secteur
La suspension du programme HOPE/HELP, qui affaiblit l’industrie textile haïtienne, fait écho à une autre décision passée : l’interdiction des mangues Francisque sur le marché américain, survenue il y a bientôt trois ans.
En 2022, les États-Unis ont interdit l’importation de mangues Francisque, invoquant des préoccupations phytosanitaires. Cette variété emblématique, prisée pour sa qualité, représentait une source de revenus cruciale pour des milliers de petits producteurs. L’interdiction a été brutale, sans accompagnement, et a laissé une filière entière en déshérence.
Ces deux décisions, bien que sectorielles, participent d’une même logique : le retrait progressif des espaces de production haïtienne du marché international, sans alternative ni compensation. On ne propose pas de restructuration, on impose la rupture. Et chaque rupture renforce la dépendance — à l’aide humanitaire, aux ONG, aux missions sécuritaires.
Ainsi, de la francisque au textile, la logique est constante : effacement progressif, fragilisation sociale, soumission économique. Le fil du désengagement ne se brise pas; il s’allonge, il s’enfonce. Et chaque secteur abandonné est une part de souveraineté arrachée.
Attention : on abandonne la production pour militariser la misère !
Le retrait du soutien américain à l’industrie textile haïtienne n’est pas un accident de parcours, ni une décision technique dictée par les aléas du marché. C’est un acte politique qui s'inscrit dans une logique plus large : celle du désengagement économique au profit d’une emprise sécuritaire.
Washington ne se contente pas de couper les fils d’une industrie. Il coupe les fils d’une souveraineté. Car dans un pays où l’État chancelle, où les institutions sont minées, où les citoyens peinent à survivre, l’économie n’est pas un luxe, c’est un socle. Et ce socle, on le retire.
L’effacement industriel ne laisse pas un simple vide neutre. Il laisse un vide que l’on remplit, non pas avec des investissements, mais avec des interventions. Là où l’aiguille cesse de coudre, le fusil prend le relais. Ce n’est pas une faillite industrielle, c’est une reddition diplomatique. Une manière de signifier, en actes : « Vous ne produirez plus. Vous dépendrez. » Et dans cette dépendance imposée, ce n’est pas la coopération qui s’installe, c’est une logique de contrôle. Ce n’est pas un partenariat qui se défait, c’est une hiérarchie qui se consolide.
Twou manti Pa fon ! Ces développements en sont la preuve, s’il en faut : en Haïti, l’impérialisme américain et ses relais locaux incarnent la négation de la volonté populaire haïtienne en faveur d’un Renouveau Démocratique. Incapables de proposer des solutions enracinées dans les aspirations profondes de la majorité haïtienne, à savoir la justice, la souveraineté et la démocratie, ils préfèrent installer la répression, contrôler la misère et consolider le statu quo.
Il revient aux héritiers de Vertières, aux forces populaires et progressistes, de faire barrage à la normalisation du néant, de refuser la gestion sans vision et de réinsuffler au projet national une direction fidèle à la volonté du peuple.

References :
Vyal, K. (2025, octobre 1). Fin du programme HOPE/HELP : un coup dur pour l’industrie textile d’Haïti. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/fin-du-programme-hope-help-haiti-textile-2025
Zephyr, A. (2023, July 31). La rareté des mangues francisques aux États-Unis, un symbole de l’aggravation de la crise haïtienne. Boukan News. https://boukannews.com/la-rarete-des-mangues-francisques-aux-etats-unis-un-symbole-de-laggravation-de-la-crise-haitienne






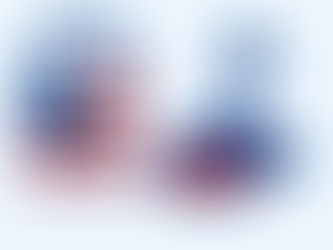





Mon cher