La chute symbolique des chefs de gangs dans l’imaginaire haïtien: entre mythe, terreur et effacement
- Renouvo Demokratik
- 13 sept. 2025
- 6 min de lecture
Dernière mise à jour : 14 sept. 2025
Par : Alain Zéphyr, Sociologue

Cette semaine, une amie particulièrement avertie des dynamiques qui traversent les réseaux sociaux haïtiens — et avec qui j’échange régulièrement sur la crise sécuritaire du pays — a tenu à attirer mon attention sur les nombreuses spéculations entourant la disparition médiatique de Johnson André, alias Izo, chef du gang armé 5 Segond.
Au-delà du simple fait divers, cette observation semble révéler un phénomène socioculturel plus profond : la chute symbolique du chef de gang dans l’imaginaire collectif haïtien.
Elle suggère qu’au cœur d’un contexte marqué par l’effritement des institutions et la gangstérisation de l’espace public, la disparition d’une figure criminelle ne se joue pas uniquement sur le plan physique ou judiciaire, mais dans le champ du récit, de la mémoire et de la représentation.
Ce processus discursif, nourri par la désinscription progressive des figures, les spéculations persistantes et la recomposition de la mémoire collective, s’apparente à un mécanisme de régulation sociale, une manière pour le collectif de réinvestir l’espace symbolique laissé vacant par le retrait de l’État, et de reprendre la main sur le récit là où les institutions ont failli.
Le rituel silencieux de la désacralisation
Le chef de gang haïtien ne surgit pas ex nihilo. Il est le produit d’un environnement chaotique, souvent façonné et instrumentalisé par des élites politiques en quête de contrôle indirect. Il représente un pouvoir informel et opaque, opérant en marge des institutions officielles tout en les parasitant. Son ascension, bien que fulgurante, repose sur une hyper-visibilité médiatique aux accents morbides : diffusion de contenus violents, ostentation d’armes, mise en scène d’excès et de slogans provocateurs. À travers cette exposition, le chef de gang performe sa puissance comme une figure tragique, inscrite dans une dramaturgie sociale où la chute est inévitable.
Cette chute des chefs de gangs, dans l’imaginaire haïtien, excède largement la dimension physique. Elle s’inscrit dans une logique intensément symbolique, presque rituelle, où l’effondrement de leur image publique prend la forme d’un acte spectaculaire de désacralisation. Ce processus ne se limite pas à réduire leur visibilité ou à imposer le silence : il cherche à les soustraire du paysage mental collectif, à effacer les signes de pouvoir, de fascination ou de crainte qui les avaient érigés en figures dominantes. Dans cette logique, le chef de gang n’est pas mort, il a simplement été effacé, vidé de son aura, déprogrammé.
Les apports des sciences sociales à la compréhension de ce phénomène
En Haïti, la neutralisation durable des chefs de gangs demeure rare et souvent inachevée. Leur chute symbolique constitue un mécanisme central de régulation narrative et politique, et s’affirme comme un levier décisif pour reprendre la maîtrise du récit collectif et reconfigurer les rapports de pouvoir. Elle repose sur plusieurs cadres théoriques complémentaires.
La notion de pouvoir symbolique, telle que développée par Bourdieu, montre que l’autorité du chef de gang dépend moins de la force physique que de la reconnaissance sociale et de sa visibilité dans l’imaginaire collectif (Bourdieu, 1991). Cette visibilité est construite par une mise en scène médiatique, où le chef performe sa puissance à travers des rituels visuels et narratifs, dans une logique de spectacle (Debord, 1967) et d’interaction codifiée (Goffman, 1959).
La mémoire collective, telle que conceptualisée par Halbwachs, et les imaginaires instituants selon Castoriadis, éclairent comment ces figures s’inscrivent durablement dans les récits sociaux, parfois sous forme de mythes persistants (Halbwachs, 1997; Castoriadis, 1975). La chute symbolique implique alors un travail de désinscription et de reconfiguration narrative, où le collectif redéfinit ses repères et ses figures de légitimité.
Avec la théorie de la performativité, telle que développée par Butler, on comprend que l’identité du chef de gang peut être « déprogrammée » en interrompant les actes répétitifs qui le maintiennent dans son rôle dominant (Butler, 1990).
Le paradigme de la justice transitionnelle propose une lecture réparatrice : en l’absence de justice pénale, le récit et la mémoire deviennent des outils de régulation sociale (Teitel, 2000). Enfin, la critique de la gangstérisation révèle que ces figures occupent les vides laissés par l’État, et que leur effacement symbolique participe à une reconquête citoyenne de l’espace public (Caldeira, 2000).
Ainsi, la chute symbolique devient un espace de lutte pour le sens, un levier de désactivation du pouvoir informel et un instrument de justice mémorielle. La chute symbolique est un processus. Elle ne se décrète pas. Elle s’insinue lentement dans les imaginaires. Elle désarme le mythe quand le corps reste debout. Elle libère les consciences, là où les armes échouent à libérer les rues.
Le cas d’Izo : entre effacement et spectralité
Johnson André, alias Izo, dirige le gang armé 5 Segond, basé au Village de Dieu, à Port-au-Prince. Recherché par les autorités haïtiennes et américaines, il fait l’objet d’une plainte pénale déposée en mars 2025 dans le District of Columbia et a été sanctionné par l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) pour violations graves des droits humains.
Depuis l’attaque par drones en juin 2025, Izo incarne avec force la dualité cruciale entre chute physique et chute symbolique. Blessé, peut-être mort, il n’a plus communiqué. Aucun message, aucune vidéo, aucun slogan : le silence s’est installé. Mais ce silence n’est pas une disparition, il est une présence spectrale. Izo est là, dans l’absence, suspendu entre mythe et réalité, entre rumeur et oubli.
Son effacement physique ne s’est pas encore traduit par une désactivation complète du récit. Il hante les conversations, les affiches, les peurs. Il est évoqué, redouté, parfois même réinventé. Cette persistance dans l’imaginaire collectif montre que la chute symbolique est un processus lent, incertain et profondément narratif. Elle ne dépend pas seulement de la mort ou de la capture, mais de la capacité à désinscrire la figure du chef de gang des récits sociaux, à démystifier son pouvoir, et à réorienter les imaginaires vers d’autres figures de légitimité.
La disparition du chef de gang Odma dans l’Artibonite a été traversée par les mêmes dynamiques discursives que celles d’Izo, illustrant une fois encore le rôle central du récit dans la gestion du pouvoir informel. Odma, à la tête de la base Gran Grif dans la région de Savien, incarnait une figure de domination territoriale et symbolique. En janvier 2021, il aurait été tué lors d’une offensive des forces de l’ordre, selon des témoignages recueillis sur place.
L’incertitude entourant sa mort, marquée par l’absence de confirmation officielle et la circulation de rumeurs, a ouvert un espace narratif instable. Ce flou alimente à la fois la persistance du mythe et le début de sa désactivation. Le récit de sa chute, plus que l’événement lui-même, devient le véritable terrain de recomposition du pouvoir
La chute symbolique comme arène de légitimation conflictuelle
Dans l’imaginaire haïtien, la chute symbolique est souvent contestée, instrumentalisée, négociée. Elle devient un terrain de lutte entre récits concurrents :
Les gangs eux-mêmes tentent de maîtriser leur propre chute, en diffusant des vidéos post-traumatiques, des messages de défi ou en orchestrant leur disparition comme un acte de puissance.
Les autorités, quand elles communiquent, cherchent à imposer une lecture de la chute comme victoire étatique, souvent sans relais narratif durable.
Les citoyens, les artistes, les journalistes, eux, tentent de reconquérir le récit, en exposant les victimes, en ridiculisant les figures tombées, ou en réécrivant la mémoire des quartiers.

- -Pc: Le Relief Francisco Silva-
La chute symbolique se transforme ainsi en un lieu de tension narrative, un espace disputé où chaque camp cherche à s’approprier le sens de la disparition. Le chef de gang, jadis omniprésent dans les récits populaires et parfois même auréolé d’une forme de glorification, glisse peu à peu vers une zone d’indistinction, une figure en retrait, effacée, désavouée, reléguée aux marges de la mémoire collective.
Conclusions
La chute symbolique représente dans bien des cas, le seul terrain de justice réellement accessible au peuple. Là où les institutions échouent à traduire l’impunité en responsabilité, le récit prend le relais. Cette chute ne se limite pas à l’effacement d’une figure. Elle opère comme un désarmement symbolique du mythe, une réécriture de la mémoire et une tentative de réparation d’une blessure collective, longtemps ignorée.
Elle n’est pas un supplément narratif, ni un simple épilogue à la violence : elle est une reconquête, un acte de résistance contre l’effacement des torts, une forme de justice transitionnelle par le verbe, par la mémoire, par la parole partagée.
Elle permet aux communautés de reprendre la maîtrise du récit, de désinscrire les figures de domination et de réorienter les imaginaires vers d’autres formes de légitimité. En ce sens, elle ne relève pas du folklore ni de la rumeur : elle est politique, performative et réparatrice.
En filigrane de la société haïtienne, ces processus diffus battent comme le pouls discret d’un peuple en éveil — un peuple qui, malgré les silences institutionnels et les violences systémiques, cherche à faire entendre sa quête de justice et de renouveau démocratique. Ce ne sont pas de simples murmures : ce sont les prémices d’une ère nouvelle, les éclats d’un espoir qui refuse de mourir, les lueurs obstinées d’une nation qui réécrit son destin à voix basse, mais avec force.

Références théoriques mobilisées
Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Harvard University Press
Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.
Caldeira, T. P. R. (2000). City of walls: Crime, segregation, and citizenship in São Paulo. University of California Press.
Castoriadis, C. (1975). L’institution imaginaire de la société. Seuil.
Debord, G. (1967). La société du spectacle. Buchet-Chastel.
Goffman, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1 : La présentation de soi. Les Éditions de Minuit.
Halbwachs, M. (1997). La mémoire collective. Albin Michel. (Ouvrage original publié en 1950)
Teitel, R. G. (2000). Transitional Justice. Oxford University Press






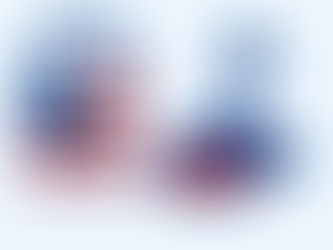





Commentaires