À l’ONU, pour qui résonne la voix de Laurent Saint-Cyr Lamothe?
- Renouvo Demokratik
- 23 sept. 2025
- 5 min de lecture
Dernière mise à jour : 24 sept. 2025
Haïti : épave sans gouvernail, emportée par les vents du chaos, sous un ciel devenu tombeau collectif
Par : Novavox , Notre Éditorial.-
Ils tombent sans bruit — mais leur absence hurle.
Le sol est saturé de noms que nul ne prononce.
Ils ne sont pas des chiffres.
Ils sont des visages, des filiations, des résistances.
Les morts ne demandent pas la pitié.
Ils exigent la justice.
Même les tombes improvisées savent parler.
Mais qui écoute ?
La situation sécuritaire en Haïti se dégrade à un rythme vertigineux. Chaque jour, les bilans humains s’alourdissent. Les cadavres s’amoncellent dans les rues, souvent sans sépulture, sans nom et sans reconnaissance. Le pays s’enfonce dans une obscurité sans veille, où la violence se déploie sans entrave, sans contre-pouvoir, sans mémoire garantie.
Les gangs armés redessinent la carte du territoire par la terreur, pendant que les institutions chancellent et que l’État semble avoir déserté les lieux du drame. Chaque localité devient un point stratégique dans une géographie de l’effroi. La violence impose ses frontières et la peur dicte ses lois. Mais cette défaillance ne se limite pas aux zones de conflit : elle s’étend aux routes, aux infrastructures, aux services publics.
Le sang des communes trace la chute d’une nation
À Laboderie, dans la commune de Cabaret, les 11 et 12 septembre 2025, plus de cinquante civils ont été massacrés par le groupe armé Viv Ansanm. Des dizaines de maisons ont été incendiées, des corps abandonnés dans les broussailles, certains selon le RNDDH retrouvés dévorés par des chiens. Ce massacre d’une cruauté extrême s’est déroulé dans un silence institutionnel glaçant, malgré les appels désespérés des rescapés.
Le jeudi 18 septembre 2025, la commune de Bassin-Bleu a été frappée de plein fouet par une attaque armée d’une violence inédite, menée par le gang Kokorat San Ras, originaire de Ti Bwadòm dans l’Artibonite. En plein jour, une soixantaine d’hommes lourdement armés ont envahi les rues, semant la panique et le chaos.
Le commissariat a été incendié, les bâtiments publics ravagés, les domiciles pillés et les citoyens pris en otage. Parmi les victimes, le professeur Jhon Guerby Dorvilien a été tué puis brûlé, symbole tragique de l’effondrement de l’ordre et de la dignité humaine.

L’offensive brutale a contraint les forces de l’ordre, mal équipées et en sous-effectif, à battre en retraite. La population, livrée à elle-même, a fui à travers les montagnes, franchi des rivières, et emprunté des sentiers escarpés pour rejoindre des zones plus sûres. Cette attaque marque un tournant: Bassin-Bleu, longtemps épargnée, devient une nouvelle ligne de front dans l’expansion territoriale des groupes armés
Le 17 septembre, à Jeanton, à l’entrée sud de Saint-Marc sur la route nationale numéro 1, un camion-remorque a violemment percuté une camionnette de transport en commun. Le choc, survenu aux premières heures du matin, a endeuillé la cité de Nissage Saget : huit passagers ont perdu la vie sur le coup, et plusieurs autres ont été grièvement blessés. Le véhicule, qui assurait la liaison entre Pont-Sondé et Montrouis, a été écrasé par le camion dans un virage étroit, tout près du sous-commissariat de Frécynneau.
Ce drame routier ne relève ni du hasard ni de la fatalité. Il révèle une autre facette de l’effondrement : celle où l’absence de régulation, de contrôle et de secours transforme chaque trajet quotidien en risque mortel.
À Saint-Marc comme ailleurs, l’inertie institutionnelle se mesure en infrastructures délabrées, en services absents, en citoyens livrés à eux-mêmes. L’abandon est total. Et les morts, qu’ils tombent sous les balles ou dans les ravins, s’accumulent dans un silence devenu structurel.
À Kapenyen, section communale de L’Estère, une nouvelle attaque du gang Kokorat San Ras a plongé la localité dans l’horreur. Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2025, des hommes lourdement armés ont incendié un moulin à riz, pillé des habitations et semé la terreur parmi les habitants de cette zone du Bas-Artibonite. Cette attaque, bien que destructrice, n’a entraîné aucune perte en vies humaines.
Enfin, alors que la nuit tombait sur Liancourt, ce 14 septembre 2025, des hommes armés ont envahi la commune. L’attaque, menée par le gang Gran Grif, a transformé cette localité du Bas-Artibonite en zone de guerre, marquant un nouvel épisode sanglant dans la spirale de violence qui ravage la région. Selon plusieurs sources locales et journalistiques, les assaillants ont incendié des habitations, pillé des commerces et semé la panique parmi les habitants. Le commissariat de Liancourt a été pris pour cible et entièrement ravagé par les flammes. Les forces de l’ordre, isolées et impuissantes, ont cédé sous la pression. Sans protection ni secours, des centaines de personnes ont pris la fuite à pied, portées par l’urgence de survivre. Les témoignages recueillis évoquent un cauchemar prolongé, une commune vidée de sa population, transformée en ville fantôme, où ne résonnent plus que les tirs et les cris de détresse.
Omission, impunité, terreur : les piliers du retrait
En Haïti, les drames ne surgissent pas dans le vide. Ils s’inscrivent dans une trame continue, révélatrice d’un régime de retrait institutionnel. Chaque accident, chaque fusillade, chaque effondrement n’est pas un fait isolé, mais le symptôme d’une architecture du vide. Les infrastructures se délitent, les services disparaissent, et les vies ne comptent que dans les bilans posthumes. L’État ne protège plus : il se retire, délègue au hasard, et laisse mourir.
Ce retrait n’est pas passif. Il est stratégique. Le silence des autorités face aux urgences, aux violences, aux catastrophes n’est pas une absence — c’est une forme d’action. Il permet l’impunité, couvre les responsabilités, perpétue la terreur. Chaque absence de secours, chaque non-réponse, chaque déni de responsabilité constitue une participation déguisée. L’État haïtien ne tue pas seulement par les armes : il tue aussi par omission. Et lorsque cette omission devient norme, elle devient crime.
Ce crime silencieux transforme les routes en pièges, les quartiers en zones de chasse et le quotidien en menace permanente. Ce n’est pas l’impuissance : c’est une politique. Une politique du retrait, de l’effacement, de la terreur ordinaire.
Résister ou disparaître : l’urgence d’un sursaut collectif
Face à une architecture du vide, où l’État se retire, où les infrastructures se délitent, où les urgences restent sans réponse, la résignation n’est plus une option. Il faut résister — non par posture, mais par nécessité vitale.
Résister, c’est nommer les responsables, les structures, les complicités qui rendent possible la répétition des drames. C’est refuser la banalisation du risque, la normalisation de la mort et l’organisation du silence comme mode de gouvernance.
Résister, c’est refuser de disparaître. C’est refuser que la mort devienne ordinaire. C’est refuser que l’abandon devienne régime.
Résister, ce n’est pas seulement refuser. C’est inventer. C’est reconstruire. C’est faire exister ce qui manque, là où tout menace de disparaître. Il faut créer des réseaux de veille citoyenne capables de repérer, alerter et relayer les violences.
Il faut bâtir des solidarités durables — locales, diasporiques, transversales — qui protègent, qui soignent, qui soutiennent. Des lieux-refuges, des espaces de soin, des plateformes de mémoire. Et surtout, il faut ériger des contre-pouvoirs : des voix collectives, des structures autonomes, des formes d’organisation capables de répondre là où l’État abandonne.
C’est de ces dynamiques que naîtra le renouveau démocratique, celui que réclame Haïti. Il ne viendra ni d’en haut ni de l’extérieur. Il ne surgira pas des structures qui ont failli, ni des dispositifs institutionnels vidés de toute légitimité. Il émergera des ruines, des solidarités locales tissées dans l’urgence, des rassemblements populaires organisés malgré l’abandon, des voix qui refusent le silence.
Ce renouveau ne sera ni rapide ni linéaire. Il sera rugueux, lent, traversé de douleurs. Mais il sera authentique, parce qu’il naîtra du peuple et non des structures qui l’ont trahi.







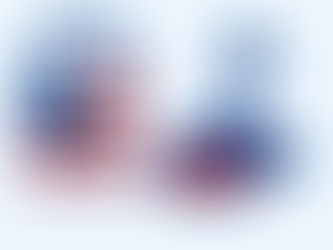





Commentaires