18 Mai au Cap-Haïtien : le drapeau couvre la honte
- Renouvo Demokratik
- 20 mai 2025
- 6 min de lecture
Par : Hugue CÉLESTIN,
Membre de :Federasyon Mouvman Demokratik Katye Moren (FEMODEK) &
Efò ak Solidarite pou Konstriksyon Altènativ Nasyonal Popilè (ESKANP).

Il faisait chaud sur le pavé délabré. Ce n'était pas une chaleur ordinaire ; c'était une chaleur de colère, de désespoir. Une de ces chaleurs lourdes où même les saints voudraient descendre de leurs niches en bois pour fuir l'indécence. À la cathédrale du Cap, on célébrait le Te Deum de l'hypocrisie nationale du drapeau. Alignés comme des choristes mal accordés, les membres du Conseil Présidentiel des Truands (CPT), le Premier ministre Alix Didier Fils Aimé et toute la clique ministérielle, grands commis de l'État sans bilan attendaient pieusement la bénédiction de Dieu, ou plutôt celle de la presse.
Né à l'Arcahaie un 18 mai 1803, le drapeau haïtien est le fruit d'un geste fondateur. Un acte de rupture, d'indépendance, de souveraineté, de couture symbolique ; le blanc fut arraché, comme on arrache un oppresseur, pour coudre l'unité dans la douleur et la dignité. Ce geste devait, chaque année, rappeler aux enfants de la patrie l'audace des ancêtres et la promesse d'un destin collectif.
Mais aujourd'hui, rongée par les vers de la corruption, piétinée par les bottes de la dépendance et de la gangstérisation, cette mémoire est traînée dans les flaques des combines politiciennes. La cérémonie commémorative du drapeau, autrefois flamme de cohésion, est devenue une caravane pitoyable, errante au gré des caprices dû à la marque du pouvoir: "CARICOM made in USA". Séquestré par la peur, exilé par la lâcheté, le drapeau n'a plus droit de cité à l'Arcahaie. Cette année, la cérémonie officielle a fait escale au Cap-Haïtien, dans un décor de: " Ti Sourit/Atè Plat"; théâtre provisoire d'une République en lambeaux, maquillée à grands frais pour impressionner le public.
Pendant que les officiels, emperruqués et amidonnés, faisaient retentir trompettes et Te Deum à la cathédrale du Cap-Haïtien, le tout financé sans vergogne à coups de 299 millions de gourdes siphonnées des caisses publiques, le pays réel, lui, suffoquait.
Corrompus et corrupteurs avaient soigné la mise en scène : estrades clinquantes, drapeaux en plastique qui fondaient presque sous le soleil, banderoles en cascade, tapis rouges déroulés sur des rues crevassées, jonchées d'immondices accumulées par des années de négligence. Tout y était : fanfares grimaçantes, participants cravatés jusqu'à l'étouffement, sourires narquois, regards vides. Une République transformée en carnaval de pillards, ignorant le peuple qu'ils espéraient trop épuisé pour huer.
Tout cela pour une République sans public. Car le peuple, lui, n'était pas invité à cette grand-messe du mensonge. Il avait d'autres urgences ; un peu d'eau, un morceau de pain, quelques heures d'électricité, un souffle de sécurité, une miette de dignité. Et pendant que les notables psalmodiaient leur fausse piété, l'agonie gisait, silencieuse, dans les couloirs d'un hôpital public où même la mort hésite à entrer, par peur d'y mourir aussi.
À l'Hôpital Universitaire du Cap-Haïtien, ce jour-là, les cris des malades couvraient les cantiques hypocrites de la cathédrale. Là-bas, on célébrait les symboles. Ici, on enterrait les vivants. On manquait de tout : oxygène, gants, seringues, sérum, personnel, espoir. Même la mort semblait débordée. Sur un brancard bringuebalant, une vieille dame, peau collée aux os, soufflait faiblement : "M ap soufri, men m ap viv paske m gen espwa". Mais l'espoir, justement, n'est pas une devise de façade qu'on agite dans un discours. Ce n'est ni une médaille ni une plaque dorée que des gouvernants s'échangent entre deux sourires complices. L'espoir ne se déclame pas sur une estrade sous escorte policière, pendant que le peuple crève sans flash ni micro. L'espoir se gagne ; il ne se décrète pas.
Dans la foulée, le scandale vire à la farce académique. Un groupe d'étudiants, triés sur le volet comme des mangues encore vertes, issus d'une certaine Université Privée/Publique du Gouvernement, fait son entrée en scène. Recrutés par un pouvoir en mal de légitimité, ils ne servent ici que de décor vivant ; une caution juvénile pour maquiller la voyouterie. Le 17 mai, Journée Nationale des Enseignants, dans une salle enguirlandée de faux lauriers et de vrais mensonges, ces étudiants ont solennellement remis la plus haute distinction de l'Université au Premier Ministre Alix Didier Fils Aimé, l'homme au mandat aussi flou que ses résultats. Le recteur, la bouche pleine de mots aussi gonflés que vides, déclare sans ciller : « Pour sa brillante invention de drones kamikazes protecteurs des gangs-milices. »
Rires étouffés ! Le vide est couronné, l'incompétence est élevée au rang d'excellence, la faillite nationale est emballée sous ruban universitaire. Une médaille suspendue à un torse sans bilan, pendant que dans les hôpitaux, les malades meurent faute d'aspirine et de gouvernement.
Le peuple en colère n'a pas mis longtemps à se faire entendre
À l'intérieur, les notes du Te Deum résonnaient encore, fausses comme les promesses électorales. Tandis que les autorités, les yeux levés vers les voûtes de la cathédrale ou vers le plafond de leur hypocrisie feignaient une conversation avec Dieu. Les éducateurs, ces éternels sacrifiés de la République, ont décidé de rompre la liturgie, ils ont exigé justice, à défaut de salaire.
Dieu, fidèle à sa discrétion ces derniers temps, n'a pas daigné répondre. Mais un policier, lui, s'en est chargé ; visiblement sorti trop tôt du lit et trop tard de ses illusions. En retard de plusieurs mois de loyer, étranglé par les frais de scolarité de ses quatre enfants déjà renvoyés de l'école, il a tenté de repousser l'enseignant d'une gifle aussi bancale que sa situation. L'enseignant, homme de lettres certes, mais aussi homme de nerfs lui a rendu la pareille en espèces et avec les intérêts. Le reste de la troupe a alors sauté sur lui comme s'il s'agissait d'un voleur, d'un criminel ; lui qui dénonçait les vrais.
La scène se prolonge, car la réelle messe, la seule qui vaille, se célèbre dans la rue. Sur le parcours officiel, les voix ont jailli comme des coups de tonnerre. Les slogans, eux, sont sortis tout droit des entrailles : "Aba vòlè yo ! Pote kòd pou mare nèg Bidjè Lagè a. Ensekirite ap mandjangwe nou !"; "299 milyon goud pou fè defilé pou vòlè, atoufè kriminèl !" Les murs du Cap ont tremblé. Pas de respect feint pour des autorités qu'on ne reconnaît plus. Pas de silence devant la mascarade d'un pouvoir qui investit dans le vol, la corruption et méprise la vie du peuple. Pendant ce temps, dans l'hôpital, une infirmière surmenée confiait, entre deux urgences : "Nan non drapo; chèf yo piye , yo vole 299 milyon goud, pa gen 299 mil senk kòb pou achte gaz pou laboratwa lopital la !"
Haïti n'est pas seulement en crise ; elle est en coma profond, branchée à la perfusion de l'indifférence générale. Chaque fête nationale sonne désormais comme un hommage hypocrite à sa lente désintégration. La fête du drapeau est profanée. La fête de l'université est dévoyée. Cette commémoration n'a plus rien à voir avec Catherine Flon, ni avec l'Arcahaie, encore moins avec la situation chaotique que traverse le pays. Ce jour, jadis symbole de dignité et de courage, s'est mué en carnaval lugubre où des autorités en cavale morale paradent sans honte, célébrant leur propre imposture sous les projecteurs complices de caméras.
Être haïtien c'est naître sous un drapeau que les dirigeants ne reconnaissent plus. Vivre dans un pays où le pouvoir est une mafia légalisée par la Communauté internationale, où la dignité se paie cher; où la justice et l'éducation sont devenues des délits; où la vérité se fait tabasser; où la santé est un luxe; où le vol, la corruption et la soumission aux puissances locales et étrangères sont érigés en vertus. Mais nous ne laisserons pas l'amnésie collective nous voler ce que nos ancêtres ont cousu dans la douleur : un drapeau, une fierté, une liberté.
Aujourd'hui, le drapeau essuie les crachats des arrivistes, au lieu d'une célébration, nous avons assisté à un enterrement symbolique ; celui de la décence ! Le 18 Mai ne peut pas être la fête d'un pouvoir en déroute. Il est et restera la mémoire vivante de notre combat contre toutes les formes d'oppression ; y compris celles qui se cachent derrière les rideaux blindés des cérémonies officielles, incapables de marcher aux côtés du peuple sans une escorte surarmée non pas pour le protéger, mais pour l'écraser.
Tant que l'hôpital souffre, tant que les écoles ferment, tant que les gens hurlent «à bas les dirigeants voleurs»dans les rues, aucune médaille ne saurait effacer le bon mépris. Et si la République est en soins palliatifs, c'est à nous de refuser qu'elle meure entre les mains des charlatans.






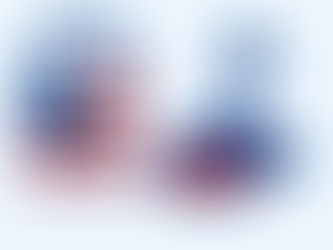





Commentaires